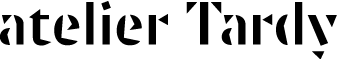Expertise métier : prestataires de services intellectuels, un monde à part

Ce constat est le suivant : ces métiers constituent un monde à part, différent de celui de l’industrie par de nombreux points, méthodes de travail, problématiques économiques, domaines d’investissement… Les approches en termes de gestion elles-mêmes sont totalement différentes.
Autant de raisons qui rendent nécessaire l’application de concepts et méthodes de gestion spécifiques à ces métiers.
Paroles d’expert : les bonnes pratiques de gestion

Industrie et Prestations de services intellectuels : des investissements très différents
L’un des critères de différenciation entre les métiers de la prestation de services intellectuels et les autres, qu’ils concernent le monde industriel ou celui des autres prestations de services, est le niveau d’intensité capitalistique, très faible pour les services intellectuels, à l’inverse de l’industrie.
Le monde industriel est caractérisé par des investissements matériels importants, alors que c’est l’investissement dans le facteur humain qui est largement prépondérant dans les métiers du conseil, de l’ingénierie et de l’architecture.
Dans ces conditions, le coût de production ne peut être déterminé de la même manière dans l’industrie et les métiers de prestation de services intellectuels.
.
.

L’industrie, forte de ses investissements, doit avant tout gérer des charges
Le monde industriel a eu, à l’origine, le mérite de développer et de conceptualiser les grands principes, enseignés aujourd’hui dans les écoles de gestion. Fondés sur une production de masse, ils comportent une décomposition du coût de production entre coûts fixes et coûts variables ; les stocks physiques qui apparaissent dès lors qu’une partie de la production ne fait pas l’objet d’une livraison et d’une facturation immédiate, sont évalués sur la base de leur coût de production.
La plupart des progiciels de gestion disponibles sur le marché ont été conçus pour répondre aux besoins et à la demande des services fonctionnels des entreprises industrielles. Cela explique leur inadéquation au monde de la prestation de services intellectuels, et ce quels que puissent être les efforts consentis par les éditeurs qui s’intéressent à ce marché pour tenter d’adapter leurs produits : c’est en effet dans leur conception même qu’ils sont inadaptés à la spécificité de ces métiers.

Les prestataires intellectuels, pour renforcer leur capital humain, gèrent des produits
Ces principes généraux ne conviennent pas à la production de services intellectuels, pour lesquels chaque opération constitue quasiment un prototype, et dont les coûts variables sont très faibles. Par ailleurs, la production non facturée est constituée d’en-cours de production de services, dont l’évaluation est souvent extrêmement délicate.
La problématique majeure du système de gestion dans le monde du conseil et de l’ingénierie n’est pas de connaître le nombre de contrats ou le chiffre d’affaires à réaliser pour couvrir les charges fixes de l’entreprise, constituées pour une part très importante de l’amortissement des équipements productifs, et par la suite d’utiliser le facteur « main d’œuvre » comme variable d’ajustement.
En revanche, on a besoin, dans ces métiers, d’optimiser l’utilisation de la ressource « capital humain » qui constitue le plus souvent la première richesse de la structure, et que l’on cherche généralement davantage à conserver et à enrichir qu’à « ajuster » au gré des contraintes économiques.

De la nécessité de privilégier les solutions « métier »
Ce n’est donc pas la taille de la structure qui doit déterminer la conception de son système d’information, mais bien le métier qu’elle exerce.
Les concepts mêmes de la gestion sont donc fondamentalement différents, ce qui devrait conduire au choix d’une solution spécifique métier, dont le principe de calcul doit être bâti non sur une affectation directe des charges déterminant un coût de production (schéma classique des PGI du marché), mais sur une répartition par contrat des dépenses globales de chaque entité concernée.
C’est justement l’un des principes fondamentaux retenus dans le développement de notre progiciel Pythagore, système d’information de gestion développé par une équipe experte et investie, et destiné exclusivement aux métiers de prestation de services intellectuels : conseil, ingénierie, architecture.

Fort besoin d’irriguer la structure en profondeur pour responsabiliser les acteurs
Comme évoqué plus haut, ces métiers sont caractérisés par la prépondérance du facteur humain dans la hiérarchie des ressources de l’entreprise. Le niveau de compétence de nombre de collaborateurs est généralement élevé, et les responsabilités qui leur sont confiées dans l’exercice de leurs fonctions sont habituellement importantes. Or, une large responsabilisation des collaborateurs nécessite que chacun puisse disposer des informations nécessaires le plus rapidement possible.
En conséquence, un logiciel de gestion bien conçu devrait permettre à tous les acteurs directement impliqués, qu’ils soient fonctionnels ou opérationnels de disposer en temps réel de données complètes leur permettant d’évaluer les performances constatées et prévisionnelles par le biais d’indicateurs simples et homogènes, ceci pour l’échelon pertinent qui les concerne : l’affaire, le centre de profit ou la société.
Ceci démontre l’importance de disposer d’un outil susceptible d’irriguer l’ensemble de la structure, quelle que soit son organisation, et en particulier, pour une structure multi sites, ses multiples implantations géographiques.
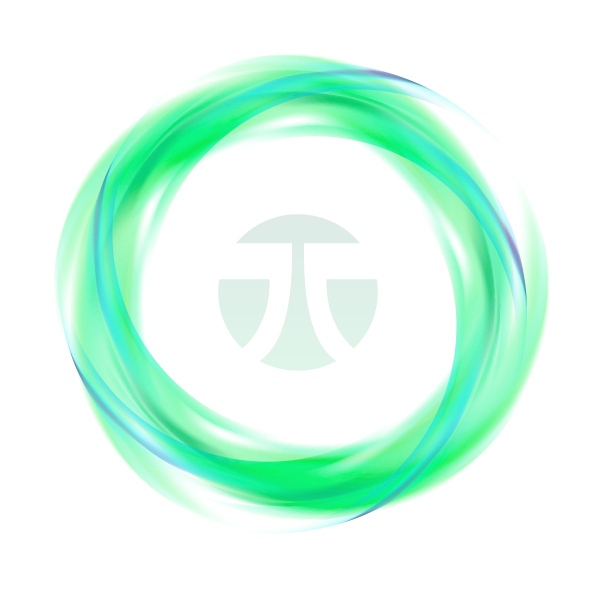
Transformer le cycle linéaire classique en un cercle vertueux d’amélioration permanente
Ainsi, grâce à cette mise à disposition en temps réel d’informations de gestion spécifiques et ciblées, le cycle de gestion « Prévision – Réalisation – Contrôle – Analyse » est appliqué en continu.
L’analyse périodique permet d’affiner et d’actualiser les prévisions régulièrement, si bien que le cycle classiquement linéaire devient un « cercle vertueux de la gestion », appliquant à la gestion le principe de base d’un système qualité.
A ce titre, le système d’information de gestion est susceptible de devenir un outil de compétitivité et d’amélioration de la performance globale de l’entreprise, l’un des facteurs clés de son succès. Et, pour peu que le progiciel soit évolutif, c’est également un solide pilier sur lequel les sociétés utilisatrices peuvent s’appuyer pour accompagner leur croissance au fil du temps.